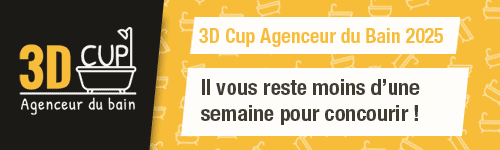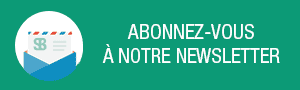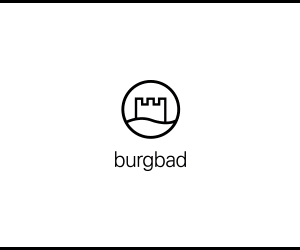Au travers de Oh ! Ça ne coule pas de source, La Fonderie, musée bruxellois, met en lumière l’eau domestique dans la capitale belge. L’exposition « cherche à rendre visible ce qui se cache derrière des gestes simples et quotidiens comme remplir un verre d’eau […] » Retraçant le parcours de l’eau, elle montre que ces questions reposent sur une longue histoire faite de choix politiques et techniques, d’acquisition de connaissances, de transformations culturelles…
Eclairer l’histoire, pour mieux appréhender le présent et le futur de l’eau, voilà le postulat de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source, de La Fonderie, musée bruxellois des industries et du travail. D’emblée, son titre interpelle : l’interjection combinée à un jeu de mot joue la surprise et invite à la découverte de façon interactive, en déconstruisant la banalité du geste, par la mise en scène d’une foule objets du quotidien, actuels ou anciens. Car il s’agit notamment de prendre conscience de l’interaction entre le mode de vie et cette ressource essentielle, qui n’a pas toujours été disponible chez soi, au robinet et de bonne qualité… et pourrait bien ne plus l’être un jour si l’on ne s’efforce pas de mieux la préserver.
C’est en suivant « le fil du réseau » que cette exposition très vivante s’attache à expliquer le cycle de l’eau domestique, se demandant par exemple d’où elle vient (pluie, rivière, nappes…), comment elle est acheminée, distribuée… Des changements pas si vieux que ça ! Des captages wallons aux aqueducs en passant par les grands réservoirs, cette fresque historique et technique commence aux prémices, avec la création en 1891 de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux (CIBE), ancêtre de Vivaqua, qui suit de peu celle du service des eaux de la ville de Bruxelles vers 1855. Des dates de fondation comparables à celles des sociétés pionnières dans la distribution de l’eau potable en France : la Compagnie Générale des Eaux (devenue Veolia) en 1853 ou encore la Lyonnaise des Eaux en 1880. Produit d’une association unique de matériaux et de gestes humains, l’on apprend que l’approvisionnement en eau potable de Bruxelles repose sur une infrastructure complexe qui comprend près de 3 000 km de tuyaux (dont 2 200 à Bruxelles), des usines, des réservoirs… pour lesquels des centaines de personnes travaillent quotidiennement.
Un grand basculement
Avec l’avènement de ce service moderne dans la seconde moitié du XIXe siècle débute la marchandisation de l’eau… Jusqu’alors gratuit, ce bien commun sera désormais monétisé, comme n’importe quelle matière première. En fonction des données cadastrales, ce sont d’abord les propriétaires qui paient, puis l’usager avec la création des compteurs. Pour accroître le nombre d’abonnés à ce service tout sauf universel, la plupart des fontaines sont retirées de l’espace public… Progressivement, l’usage des puits communs et des citernes d’eau de pluie disparaît ensuite, signant la fin de certaines formes de sociabilité, notamment autour de la corvée. Pour que chacun puisse mesurer la pénibilité de la tâche, qui est surtout une affaire de femmes, un joug à eau, système d’attelage en bois qui permettait le port de deux seaux jusque chez soi, à la force des épaules et des bras, est mis à disposition des visiteurs.
Un effort à mettre en perspective avec l’entretien permanent que nécessite le réseau. Jour et nuit différents métiers de l’ombre, sont mobilisés pour assurer le confort dont nous avons pris l’habitude et veiller à son bon fonctionnement, mesurant la pression et traquant les fuites qui représenteraient, au bas mot, entre 9 et 10 % de l’eau produite pour notre consommation…
Selon les époques, il est intéressant de noter que la définition de la « bonne eau » varie. Avant que la science ne découvre l’existence des microbes et des bactéries qui font d’elle un vecteur de maladies (tuberculose, typhoïde, choléra…), sa qualité se fonde sur des critères purement subjectifs comme le goût, l’odeur, la limpidité ou encore… la réputation. Etape importante du parcours, la reconstitution in situ d’un laboratoire invite à observer au microscope ce qui demeure invisible à l’œil nu ou procéder à des manipulations (ateliers accessibles à partir de 5-6 ans), tandis que des vidéos mettent en évidence les métiers de la chimie qui œuvrent à la potabilisation des eaux.
Dans le bain
Pourtant, la majorité des litres consommés individuellement (près de 100 par jour pour les bruxellois en 2020) sont destinés à autre chose que boire. L’eau dite d’hygiène – pour se laver, tirer la chasse, faire la lessive – constitue près de 66 % de cette consommation. Plus que toute activité ménagère, les gestes liés à la propreté des corps découlent d’une évolution des procédés en usage, avant la banalisation récente de la salle de bains dans le logement.
Il est ainsi rappelé qu’avec le retour en grâce de l’eau au XVIIIe siècle, l’hygiène devient une affaire de plus en plus intime, de sorte que même les bains publics du siècle suivant sont organisés en cabines. L’occasion d’observer qu’ailleurs dans le monde, des traditions collectives du bain et de l’hygiène ont au contraire perduré (Sentô japonais, Hammam en Afrique du nord, Banya russe…). Des pratiques culturelles qui placent l’eau ailleurs que dans les espaces privés et dont on pourrait peut-être s’inspirer.
De la bassine utilisée dans la cuisine à la salle de bains, dont la présence dans chaque logement ne s’est généralisée qu’à partir des années 1950, en passant par les bains publics qui ont fait partie intégrante de l’espace urbain avant la distribution d’eau à domicile et jouent encore un rôle à Bruxelles aujourd’hui, l’exposition plonge de manière immersive dans cette eau qui lave le corps, mais pas seulement. Par divers dispositifs inclus dans l’aménagement d’une salle de bains typique des années 1950-60, elle montre notamment l’évolution du design qui, de l’aveu des commissaires d’exposition, a perdu en excentricité depuis les années 1970.
Derrière la volonté d’offrir à tous l’accès à l’eau, notamment pour se laver, la question de la justesse de la politique sociale fait également jour. L’exposition souligne qu’actuellement entre 8 et 10 % des Bruxellois ne bénéficient pas, ou pas facilement, de cet accès. Cent mille personnes précaires seraient ainsi en proie à ce que les chercheurs nomment la vulnérabilité hydrique, que la crise sanitaire et les confinements ont certainement amplifiée.
Par les égouts
De nos jours, les toilettes à chasse d’eau évacuent les déjections des Bruxellois dans les égouts. Mais cela ne s’est pas toujours passé ainsi, sachant que jusqu’au tournant des années 2000, en l’absence de station d’épuration, les eaux usées de la ville étaient rejetées directement dans la rivière la Senne ! Comment le tout-à-l’égout s’est-il imposé dans la capitale belge alors que « l’or brun des villes » était autrefois en partie récupéré et valorisé comme engrais naturel, utilisé par l’agriculture pour fertiliser ses surfaces maraîchères comme ce fut aussi le cas notamment à Paris ? Suivant quel principe le réseau d’égouts a-t-il été construit ? Qui l’entretient ? Que deviennent les matières que nous évacuons dans les canalisations souterraines ? Comment les traite-t-on ? Avides d’expériences, les enfants pourront enfiler un équipement d’égoutier et se frayer un passage dans un tunnel reconstitué pour découvrir leur travail à rude épreuve…
Aujourd’hui, nul n’ignore l’impact du dérèglement climatique, qui engendre des précipitations et des périodes de sécheresse plus intenses. En parallèle, la consommation d’eau diminue tendanciellement, grâce une prise de conscience qui passe aussi par le développement d’appareils sanitaires et de robinetteries plus économes en eau… Alors, que faire de ce système technique complexe hérité d’une longue histoire ? Comment l’adapter aux nouveaux enjeux de la société, en perpétuelle mutation ? Ce système socio-technique pose des questions, des défis… Cet héritage, que va-t-il, que peut-il devenir ?
A propos de l’exposition
♦ Exposition Oh ! Ça ne coule pas de source, jusqu’au 26 juin 2022.
♦ Réalisée par La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail (Molenbeek-Saint-Jean), en partenariat avec Vivaqua (société belge de distribution de l’eau et d’égouttage) et le Laboratoire interdisciplinaire en Études urbaines (LIEU – Université libre de Bruxelles).
♦ Commissaires : Chloé Deligne (historienne, formée en géographie et en sciences de l’environnement), Ananda Kohlbrenner (historienne et urbaniste), Sophie Richelle (historienne, chercheuse post-doctorante à l’Université Libre de Bruxelles).
♦ Aux mêmes dates, La Fonderie accueille également le projet artistique Piss and Love, une expo carte blanche sur les toilettes publiques à Bruxelles, née de la rencontre entre un photographe et une « madame pipi », mise en valeur par un graffeur.