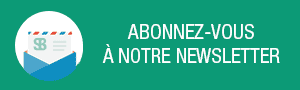« Accompagner les Français dans leur projet Maison et permettre à tous de mieux vivre chez eux est la mission que l’on se donne chez Leroy Merlin. » Le positionnement défendu par Erwan Soquet, directeur de la marque, est mis en image par le nouvel opus publicitaire de l’agence BETC, faisant le parallèle entre la destinée d’une maison et celle de ses occupants qui s’accomplissent en accomplissant : « Une vie à construire ». Décryptage.
Les premières secondes du film plongent le spectateur dans une ambiance crépusculaire. Matin ou soir d’un monde qui toucherait à sa fin, on ne saurait dire si la lueur point, annonçant un jour meilleur, ou si les ténèbres l’emportent, prélude à un inéluctable déclin. Le soleil disparu n’éclaire plus la terre que par les reflets d’un ciel nébuleux vers lequel une femme lève des yeux inquiets tandis que le tonnerre gronde sa colère (0:00).
Filmé en plan serré, ce visage tourmenté avance en silence face aux vents qui sifflent, un frêle gilet de mohair pour seule « carapace ». La tête rentrée dans les épaules, signe de peur et illusoire posture de protection face à la dangerosité d’une situation difficile à interpréter (un espace indéterminé, dans une nature a priori hostile), elle surveille un court instant ses arrières (0:01) avant de marquer légèrement le pas et d’entourer de ses bras l’enfant qui marche à ses côtés et que la caméra nous avait jusqu’alors caché (0:02).
Au moment où la figure devenue maternelle entoure le jeune garçon dont l’expression trahit la même tourmente (0:03), le plan s’élargit, laissant enfin deviner un bout d’horizon, symbole de tous les possibles, métaphore d’un avenir moins sombre vers lequel ce couple mère-enfant se dirige peut-être. Le point de vue s’ouvre alors sur un paysage ténébreux qui ressemble à un désert glacé, un lac salé peut-être. Si fragiles dans l’immensité de cette lagune inhospitalière, ils avancent, ne formant qu’un seul corps dans la froidure que soutient à l’écran un camaïeu austère de gris et de bleus (0:04).

Matérialisant le seul point de fuite possible parmi cette étendue adverse, une précaire construction de bois brave elle aussi les éléments (0:05), unique attribut de la civilisation qui soit à portée de vue sinon de vie. Alors qu’ils entreprennent d’en faire timidement le tour, à l’affût du moindre péril, la caméra observe déjà leur « ronde » depuis l’intérieur, au travers d’une fenêtre (0:06). Sur le visage de la probable mère, un sourcil qui se dresse (0:07), une pupille que la peur dilate (0:08) et on comprend qu’un élément « extérieur » va faire une entrée imminente dans ce décor post-apocalyptique.
Posté de l’autre côté de la cabane (l’abri premier, la maison-archétype des origines, celle des débuts de l’hominisation, puis des pionniers), un homme, un inconnu, se tient (0:08), lui aussi attiré par cet abri de fortune (ou d’infortune). A moins que ce ne soit son repaire, la cachette d’une personne peu recommandable ou pire, un guet-apens… Comment ne pas penser à l’errance solitaire et quasi animale des survivants du roman de Cormac McCarthy, confrontés en permanence à la violence et à la barbarie au fil de La Route ?

D’un geste protecteur, la femme fait bouclier à la possible menace et place « le petit » dans son dos (0:09). Un grondement interrompt la seconde (0:10) où les deux « camps » s’observent, figés par le doute et l’effroi. La crainte peut être un ciment… En fait, ils ne seront pas adversaires mais unis face à l’adversité : le danger ne vient pas d’eux, mais du dehors, dans un rapport antagoniste à ce monde sombre sur lequel ils se retournent une dernière fois, simultanément (0:10).
Comme une pierre secrète, ce geste de concert marque leur première action commune. Celle-ci n’est pas encore édificatrice mais déjà fondatrice et la narration suspend un temps son cours pour nous faire prendre la mesure de ce moment (0 :12). Focus éclair sur le visage de l’homme qui scrute l’abri puis cherche du regard l’approbation de son alter ego féminin (0:13), avant de batailler de tous ses muscles contre la porte (0:14) qui ne cèdera que lorsqu’ils uniront leurs forces (0 :15). Ensemble, l’un devient ainsi la clef d’entrée de l’autre puisqu’ils s’épaulent littéralement, sans hiérarchie de genre.

Contrepoint sonore aux grondements du ciel qui meublaient jusque-là un silence pesant, l’ouverture de la porte fait grand bruit (0 :16). Avec ce « coup », comme au théâtre, le réalisateur attire l’attention du spectateur lorsque le trio foule ce « plancher » qui sera donc la scène de ce drame publicitaire. Les voilà entrés, ils ont franchi ce « passage » qui fait évidemment cap comme Alice pénétrant au Pays des Merveilles ; le décor est posé, la seconde partie du scenario peut s’enclencher (0:17).
La femme referme la porte, d’un réflexe précautionneux (0:18). Ce mouvement clôture l’espace et met fin à l’introduction aux accents survivalistes. Un autre artifice auditif s’enclenche : une douce musique retentit, un carillon dont le timbre semble magique. Ces quelques notes sont un prélude allégorique au merveilleux, à l’instar des récits d’aventures imaginaires. Cette cabane inspirée des contes de fées porte en elle une force émotionnelle et philosophique puissante qui pourrait bien être le moteur d’une fable, sinon d’une utopie collective.
Malgré l’état de délabrement du bâti en partie ensablé, on devine que le rêve ne tardera pas à transfigurer la réalité : l’homme tombe la veste (0:19), la femme noue ses cheveux comme d’aucuns remontent leurs manches (0:20) : ils feront équipe. La connivence est marquée là encore par un échange de regard, plus volontaire, presque complice (0:21). Dans toutes les acceptions du terme, la « vision » qu’ils partagent amorce la suite, scellant un pacte d’entraide implicite.
Le rythme s’accélère (0:22) et chacun s’affaire à refaire. Ici une volige vermoulue qu’on arrache, là une bâche qu’on extrait du plafond. Le temps n’est plus à la stupéfaction mais à l’action, la petite mélodie thaumaturgique continuant à s’inscrire en fond, en guise de leitmotiv. Dès lors, les opérations engendrent des sons concrets, manière d’ancrer dans le réel l’entreprise de rénovation. Dans cette ré-novation, il y a l’idée de renouveler, du latin « renovare » qui vient de « novus » (nouveau). Sans doute ne le savent-ils pas encore, mais en accomplissant, ils s’accomplissent, c’est le sens d’Une vie à construire, titre de ce film.
La nuit tombe (0:24), figeant tout dans la pénombre. La caméra est ressortie deux secondes pour nous montrer deux choses, infimes à l’écran mais si déterminantes : manifestation d’espoir, une lueur timide émane du cœur de la cabane et un filet de fumée s’échappe d’une cheminée providentielle, indices d’un feu maîtrisé, dont nous savons que l’Homme avec un grand H doit sa survie (et son confort) à sa domestication. L’adjectif domestiqué étant emprunté au latin « domesticus » (qui est lié au foyer), lui-même dérivé de « domus » (maison), il doit commencer à faire bon vivre à l’intérieur de cet abri qui prend forme…

Car voilà que les lames du parquet ruiné opèrent une mue magique : ses planches-écailles se referment comme les plaies bibliques. Nous assistons au miracle de l’auto-réparation (0:25) d’une baraque-baraka. Par un mouvement oscillant, le parquet se régénère (0:27) et palpite tel un cœur, ses soubresauts réguliers pouvant aussi évoquer les touches d’un piano jouant la fameuse mélodie (du bonheur ?) qui charme les tympans.
En ce fort isolé, la quiétude règne et le sommeil s’organise… L’image nous confirme la présence d’un poêle ardent et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il réchauffe l’atmosphère… Endormi à l’autre bout de la pièce sous une couverture tel un cowboy en bivouac, l’homme roule sur lui-même, polarisé par une irrésistible attraction que rythment les ondulations du plancher. Sans sortir des bras de Morphée, il se rapproche doucement de ceux de la mère et de l’enfant qui somnolent enlacés et apaisés, au coin du feu (0:29)…

Alors qu’une étape cruciale commence à s’accomplir, celle de la re-composition prochaine d’une cellule familiale, une révélation majeure nous est faite. Si le plancher prend vie, c’est parce que le sol s’avère fertile, métaphore de ce couple en devenir, maillon à échelle 1 de celui la planète. Des racines émergent de la terre (0:30), comme autant de liens qui s’établissent profondément et croissent en renouant avec la nature. La cabane n’est visiblement plus en proie à l’enlisement, les sédiments qui s’étaient accumulés autour d’elle ne font plus obstacle et peu à peu elle s’élève, elle grandit… et ses habitants avec.

La caméra opère un zoom arrière pour revenir sur la femme, qui semble émerger elle aussi (0:33) alors que le jour transperce le bardeau des murs, mettant en lumière ses nombreuses déchirures. Le songe n’est plus une chimère : elle se retourne (0:34) pour découvrir ce que nous avons déjà aperçu, en fond de toile, silhouettes encore troubles. L’enfant rejoint l’homme dont hier encore il ne savait rien. Formant un duo inédit, ils observent tranquillement l’extérieur depuis une fenêtre (0:36).
Symboliquement, cette baie dessine un cadre (de vie, sinon un programme) où une nativité moderne a pris place (0:37). « Un abri, un toit, un foyer », la trilogie/trinité idéale est lentement ânonnée par une voix off, la parole ayant ici valeur de parabole. A la faveur d’un nouveau point de vue, la cabane commence d’ailleurs à se montrer sous un meilleur jour même si ses atours n’ont pas (encore) changé. Trans(posée) sur une prairie désormais verdoyante, elle conserve ses vieux oripeaux mais monte sensiblement en grade, campée sur ses ramifications aériennes… Les nuages menaçants se sont estompés et comme l’avenir, le ciel est devenu radieux.
Roulement de tambour/marteau (0:39)… Au chevet du plancher qu’il cheville, l’homme prend une pose digne des Raboteurs de parquet, peinture sociale et ôde au métier signée Gustave Caillebotte (0:40). Sous ses doigts, des lames invisibles filent toutes seules en formant des vagues de copeaux qui déferlent et lissent le sol à une vitesse surréaliste. Il n’en croit pas ses mains, outil extraordinaire dont il mesure enfin le pouvoir, tandis que sa compagne observe la féerie qui se joue, la mine ébahie (0:43). La fantasmagorie se poursuit lorsque le châssis de la lucarne se métamorphose en extension à pan vitré en un battement de secondes (0:45).

Dressée sur sa souche-autel dont le tronc, solide et massif, sert de pied, la cabane se dresse maintenant comme une offrande au-dessus de l’horizon (0:50). « Quoi de plus symbolique qu’un arbre pour exprimer la vie et la place essentielle que prend la maison dans chacune de nos vies ? » dit Olivier Apers, VP/Executive Creative Director de l’agence BETC. Selon un principe d’arborescence, la cabane devenue maison pousse en effet comme un végétal ligneux, réactivant le mythe de la cabane, symbole de l’état de nature promu au 18e siècle par le philosophe Jean-Jacques Rousseau.
La lumière qui pénètre par la vitre ressort dans le faisceau d’un projecteur que manipule l’enfant (0:51) avec l’aide de l’homme. Dirigé vers nous, ce rayon est une métaphore habile de la transmission du savoir et de l’imagination qui repousse les limites, y compris ici les frontières spatiales que sont les cloisons qui s’ouvrent à mesure que les images éclairées apparaissent à l’écran, celui de la pub dédoublant celui des murs déchirés, tapissés d’un ciel cinématographique (0 :53).
La construction est ici représentée comme une forme d’expression libre et créative qui invite à l’aménagement du foyer. Nos héros s’apprivoisent, évoluent et grandissent au rythme de leur maison. Cette famille nous enseigne que bâtir, c’est aussi édifier sa propre existence et celle de ses proches, philosophie à laquelle la conclusion fera écho. En matière de cycles sans fin, la nature est reine et voilà que le printemps installe sa floraison blanche aux frondaisons de l’abri arboricole (0:55), façon Sakura (cerisier) nippon.
Plateforme installée au creux des branches qui, elles aussi, établissent un lien avec la filiation, la maison a changé de physionomie. La famille compte un quatrième membre, une petite fille aux cheveux nattés qui s’adonne à la peinture dans la cuisine, pièce à vivre (et atelier à partager) par excellence (0:57). Epinglée au mur, sa production (un fameux trois mats) renvoie à la maison qui, dans la précédente campagne publicitaire de Leroy Merlin (L’Aventure d’une vie, mars 2017, réalisation Reynald Gresset, agence BETC Shopper), naviguait tel un navire sur l’océan. Une relation d’ascendance encore (0:58)…
Les contours de son œuvre s’effacent eux aussi, le trait devient volume, le dessin s’anime et fait voguer à son tour l’habitat vers des contrées oniriques (0:59). Parce qu’il suffit parfois d’une idée pour que les envies prennent vie, la petite fille fait un vœu en fermant furtivement les yeux (1:02). Dans une vision cartoonesque, un pan de mur incarne le champ des possibles, se déployant de façon télescopique (1:04). La caméra prend alors de la hauteur pour donner à voir les récentes évolutions de la maison qui n’en finit pas de s’étendre (1:05).

Une dispute enfantine (1:07) et la cabane, considérée comme l’origine de l’architecture (et point de départ de l’histoire de cette maison comme de toutes les autres), se développe aussitôt dans une énième croissance/excroissance, superposition entre les besoins et la fonction. La voix off nous explique que ce dialogue repose sur une règle nourricière, celle du « care » (soin mutuel, en anglais), facteur de bien-être et d’épanouissement réciproque : « Plus on prend soin d’elle, plus elle prend soin de nous », tout simplement. Ou comment conserver, perpétuer et soigner notre environnement, dans le but d’y vivre du mieux possible, en prélude au dernier aphorisme énoncé : « On ne construit pas simplement sa maison, c’est avec elle que l’on se construit. »
Mise en abyme parfaite du sujet, la fin suggère que tout n’est qu’éternel recommencement puisque la cabane vient de donner « naissance » à une autre qui la prolonge et accueille sans délai les jeux débridés des enfants du foyer (1:17). Des rejets/rejetons qui (encore un parallèle avec l’expansion de la végétation), depuis leur terrasse, fixent un lointain qui rime avec demain (1:23). Alentours, au moins quatre cabanes perchées se dressent dans le paysage, trajectoires parallèles qui servent sans doute de refuge altier à d’autres individus, si semblables, si différents. Un panorama dont l’enseigne repousse les limites, sa fameuse baseline ayant le mot de la fin, infinie : « Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin ».
Une vie à construire
Agence BETC x BETC Digital – Réalisateur Nicolaï Fuglsig – Directeur de la photographie Phaedon Papamichael – Agence Média Havas Media – Formats 90 s/30 s – Première diffusion 27/10/2019 – Plan média TV / VOL / Réseaux sociaux.